Nylso & Le fourbi
***
Vous vous demandiez où j'étais passée, hein, depuis le temps, je parie (allez, soyez sympa, dites-moi que vous vous inquiétiez, même si ce n'est pas vrai, ça me fera plaisir)
Eh bien, eh bien, ces derniers mois, à défaut d'alimenter ce blog, j'ai travaillé sur la rédaction d'un article, figurez-vous.
Et je peux vous dire que, à mon échelle, ça a été une sacrée aventure.
Au printemps dernier, on me fait une proposition inattendue: faire partie des contributeurs d'une revue en projet, dont le premier numéro sortirait en début d'année 2015. Une revue qui parlerait de littérature, mais pas uniquement, et qui ferait intervenir auteurs, blogueurs, photographes, illustrateurs etc. autour d'une thématique, commune à tous, et qui changerait à chaque numéro.
On me dit que, si ça m'intéresse de participer, la thématique du premier numéro, celle sur laquelle je devrais travailler, serait la suivante: "Ecrire petit".
On me présente la liste des autres contributeurs, liste qui m'enthousiasme en même temps qu'elle me fait dresser les cheveux sur la tête. En effet, je connais déjà le travail de plusieurs de mes futurs coéquipiers
(1), que j'admire profondément, et face à qui je me sens, justement, toute petite.
Qu'aurais-je à apporter à ce projet? Comment me mesurer à lui? Comment être à la hauteur?...
... Réflexion faite, je décide de profiter de cette opportunité pour me lancer dans la rédaction d'un texte autour d'un dessinateur, dont l'univers me passionne depuis bien longtemps: Nylso, auteur entre autres de la série de bande dessinée
Jérôme d'Alphagraph (en collaboration avec Marie Saur), et dont le
blog est une source constante d'émerveillement. Nylso au talent incroyable, curieux de tout, observateur d'une rare finesse, artiste de la lenteur, de la contemplation, voire de l'ennui (dans le meilleur sens du terme); Nylso dont l'amour de la littérature imprègne chacun des albums, et qui m'a fait découvrir, par ce biais, des écrivains qui allaient par la suite prendre une place décisive dans ma vie de lectrice (Robert Walser, entre bien d'autres).
Nylso à qui, donc, je voulais rendre hommage en écrivant cet article.
Il me restait à trouver une concordance entre ce "sujet" et la thématique générale de la revue.
Il me restait, surtout, à le rédiger, cet article.
Cela m'a pris du temps, beaucoup de temps, n'ayant pas l'habitude.
Je suis entrée dans un monde parallèle, celui de la rédaction d'un article: un monde où l'on parle en nombre de signes ("Bon, entre 13000 et 15000, ça me paraît bien. A 10% près. Sauf si il y a des illustrations. Du coup, ça réduit d'autant la volumétrie. Allez, disons 12500."), un monde où l'on tente plus ou moins habilement de négocier auprès du rédac'chef un délai supplémentaire pour le rendu du texte (réponse: "Ahhh, non, Clémentine, je suis désolé, ça ne va pas être possible, c'est fin octobre dernier délai... Je compte sur toi!"), un monde où l'on se pose des questions qu'on ne s'était jamais posées ("Ahlàlàlàlà mais la structure d'ensemble, merde! Je n'arrive pas à la saisir, la structure d'ensemble! Faut que je recommence. Nom d'une pipe, je n'y arriverai pas."), où le temps semble soudain s'accélérer ("Quoi? On est DÉJÀ fin octobre?! Mais c'est pas possible, je ne l'aurai JAMAIS rendu à temps!"), où l'on transpire beaucoup devant une feuille blanche - ou un écran blanc - en se disant qu'on serait tellement mieux à penser à autre chose, à sortir faire une balade ou à voir des amis, mais dès qu'on est ailleurs, à faire une balade ou à voir des amis justement, on sent que tout nous ramène à cette satanée feuille - ou ce satané écran, et qu'on va devoir, sans cesse, se confronter à ça, jusqu'à ce qu'on y arrive - car il faut y arriver (on n'a pas le choix: le délai de rendu n'est, donc, pas négociable, et il faudra remettre la copie à telle date. Et, si possible, une belle copie, ce serait quand même mieux pour tout le monde).
Bref, bref, bref. La copie a finalement été rendue à temps; elle est, ma foi, pas si mal (!), c'est donc ma contribution à cette revue à paraître très bientôt, et dont le curieux titre,
La moitié du fourbi, augure de découvertes toutes plus ébouriffantes les unes que les autres.
Pour mieux décrire le projet, je laisse la parole au comité de rédaction - sous la houlette de
Frédéric Fiolof, fondateur et directeur de la publication - qui a rédigé, pour les besoins du
site internet de la revue, ce texte de présentation:
Dans le fourbi du monde, la littérature ouvre des pistes et des espaces.
Elle invite aussi à poser le livre et à regarder autour. Le plus loin
possible comme à nos pieds, il y a matière à s’étonner, prendre plaisir,
s’émouvoir, s’effarer. Au cœur des textes et au-delà des pages, nous
faisons le pari de deux gestes portés par une même curiosité, une même
envie de donner encore à lire, à voir et à penser. A chaque numéro, une
proposition (un thème, un mot, une luciole). La moitié du fourbi
l’explore librement, réaffirmant que la littérature est l’exercice
jubilatoire le plus sérieux du monde. Une promenade, en somme, à livre
ouvert et à livre fermé.
***
Je me sens, vous l'aurez compris, on ne peux plus fiérote de faire partie de cette aventure, aux côtés d'une brillante équipe; on ne peux plus fiérote également de faire découvrir - ou redécouvrir - le travail de Nylso auprès des futurs lecteurs de la revue.
Et c'est donc avec un grand sourire et des tremblements d'émotion plein les doigts que je vous annonce
la sortie du premier numéro de La moitié du fourbi le 5 février prochain.
En attendant, et c'est important et donc j'insiste lourdement: un
appel à souscriptions est lancé, qui vous permettra de réserver votre exemplaire dès maintenant, à un prix préférentiel, et qui offrira un soutien financier non négligeable aux premiers pas de
La moitié du fourbi dans le monde.
Lisez-nous! Soutenez-nous! Embarquez avec nous!
A bientôt.
***
(1) Mes co-contributeurs sont, par ordre d'apparition au sommaire de la revue: Edith Noublanche, Anthony Poiraudeau, Hugues Leroy, Gilles Ortlieb, Zoé Balthus, Guillaume Duprat, Benoît Vincent, Sylvain Prudhomme, Anne-Françoise Kavauvea, Sabine Huynh, Hélène Gaudy, Romain Verger, Frédéric Fiolof, Samuel Gallet, Simon Kohn, et
Jacques Jouet.
Les dessins qui illustrent ce billet sont de Nylso, et sont visibles sur son blog:
nylso.aencre.org


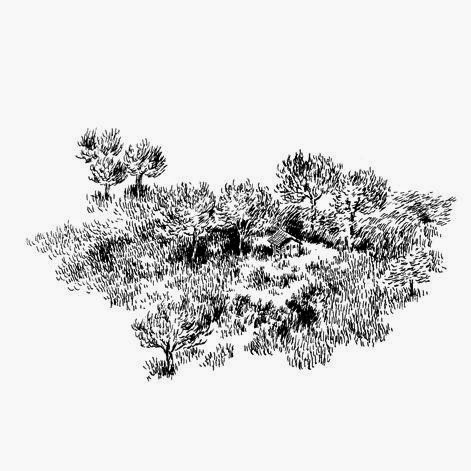




















.jpg)




