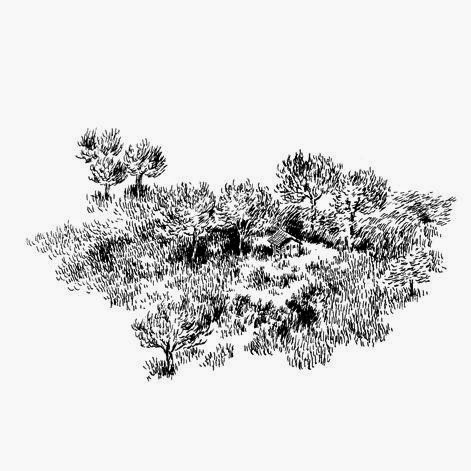Tiksi
(Comme un feu furieux,
un roman de Marie Chartres)
***
"Tiksi n'était plus depuis longtemps un port de pêche, avec ses bateaux, ses matelots venus à terre chercher du feu, de la nourriture ou de la compagnie. Tiksi était devenue une ville creuse, vidée de toute vie. Elle avait ses rituels, ses coutumes, son histoire, ses enfants, ses mères et ses pères, ses adultes riants, mais rien de ce qui restait ne semblait vivant."
Je l'ai cherchée, sur mon vieux globe terrestre datant de 1976, et je l'ai finalement trouvée, la ville de Tiksi: touchant presque le sommet du globe, au-dessus du cercle polaire arctique, au bord de la mer de Sibérie. Là où il est difficile d'imaginer que des villes puissent se dresser, et que des gens puissent les habiter. Pourtant, Tiksi existe bel et bien (j'ai envie d'écrire: coûte que coûte), et ses rues, son ciel, ses paysages, ses habitants se dessinent sous nos yeux avec une clarté singulière, dans le très beau roman de Marie Chartres, Comme un feu furieux.
Au coeur de la nuit polaire comme au coeur de leur vie, les protagonistes de ce roman avancent à l'aveuglette. On suit pas à pas la jeune héroïne, Galya, adolescente rêveuse et terriblement attachante, fragilisée, à l'instar de son père et de ses frères, par la mort de sa mère un an auparavant. Chacun de ses gestes, chacune de ses sensations, sont captés par l'auteur avec une étonnante précision, une infinie délicatesse.
"Le noir se cachait partout autour de nous. Il pendait comme un épais rideau le long des fenêtres. Il était là et m'entourait comme une grosse écharpe, il nous accompagnait du matin au soir. (...) Mes mains étaient des papillons, elles tâtonnaient le long des murs, des placards et du lavabo, à la recherche du savon ou de ma brosse à dents. Papa voulait faire des économies sur l'électricité alors depuis longtemps il nous obligeait à nous repérer dans le noir, pour que le noir puisse prendre l'apparence des choses que nous cherchions. Par exemple, la casserole que j'ai saisie pour préparer le petit déjeuner n'avait pas la forme d'une casserole, c'était juste la forme noire que j'attrapais pour la mettre sur le feu. La plupart des objets familiers deviennent un jour ou l'autre invisibles, et on continue tout de même à les saisir ou à les toucher."
Du moindre petit objet, a priori insignifiant, jusqu'à l'immensité glaciale des aurores boréales, tout prend sens, son, couleur, épaisseur. L'environnement au sein duquel évoluent les personnages est dépeint avec une attention minutieuse, par un auteur visiblement doté d'une sensibilité remarquable, faisant preuve d'un amour et d'un immense respect pour le plus petit détail, à la fois de son histoire et du cadre de son histoire. Par la grâce de ce regard, la ville de Tiksi, décharnée, mal-aimée, théâtre d'une tragédie intime, devient un personnage à part entière du roman, sujet d'attraction et de répulsion. Tiksi que l'héroïne, Galya, cherche à fuir, mais qui pourtant la retient; Tiksi qui contient le souvenir de sa mère, et qui, à ce titre, est si difficile à abandonner.
"Avant de me relever, dans le noir, j'ai pensé à Maman, étendue dans cet océan désert et neigeux, à la blancheur de la lune tombant sur son visage, et je me suis demandé si c'était là son rêve, un lieu aussi froid que celui-là, aussi loin de tout, aussi improbable. Un cimetière d'eau, un cimetière de glace. Durant quelques secondes, j'ai cru voir son visage, elle semblait ouvrir la bouche, puis le vent a poussé un cri perçant et Maman a disparu. (...) Je pensais toujours à elle, là-bas, dans son cercueil de glace. j'imaginais que c'était elle qui possédait le plus beau. Mon esprit se déployait autour d'elle comme se déployait la mer."
Tiksi, qui, avant ce roman, avait fait l'objet d'une série de photographies, réalisées par une jeune photographe elle-même native de cette ville, Evgenia Arbugaeva. C'est d'ailleurs autour de ces photographies que Marie Chartres a construit son propre récit. A travers les images de l'une comme à travers les mots de l'autre, on explore une ville abandonnée du monde, dévorée par le vide, mais où surgissent toujours des notes de couleur, de douceur. Tiksi, autrefois prospère, désormais exsangue, mais qui, pour ne pas mourir, et par le regard conjugué de ces deux artistes, devient peu à peu une terre de légendes.
***
Marie Chartres, Comme un feu furieux, Editions L'Ecole des Loisirs (collection Medium), 2014.
Images:
Globe terrestre de 1976 (photo perso)
Photographie tirée de la série Tiksi de Evgenia Arbugaeva. http://www.evgeniaarbugaeva.com